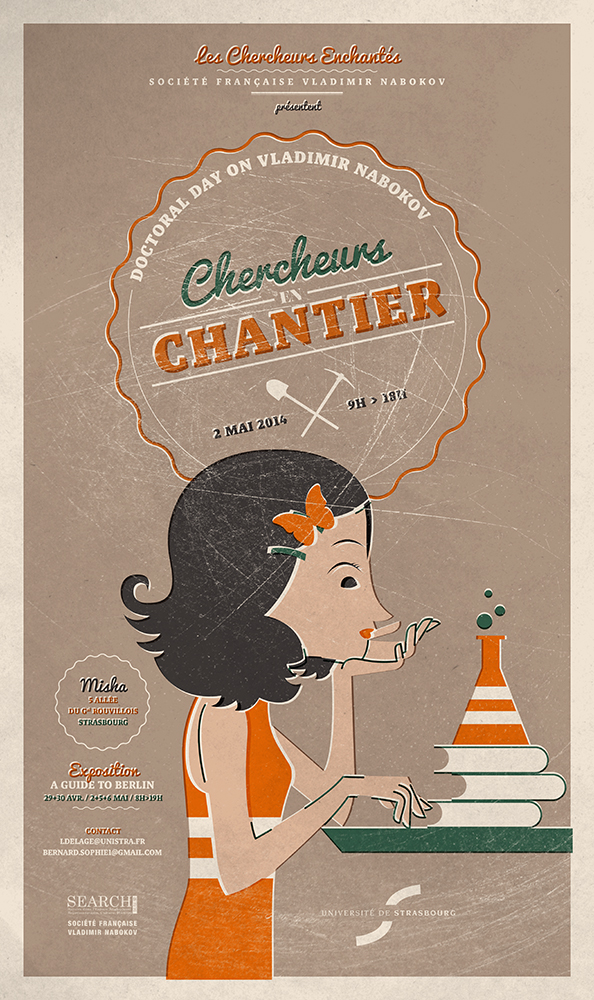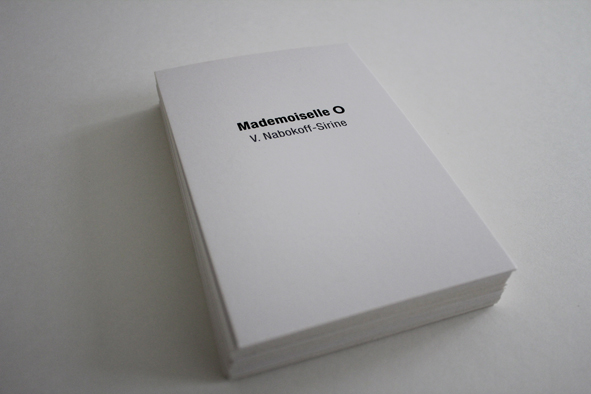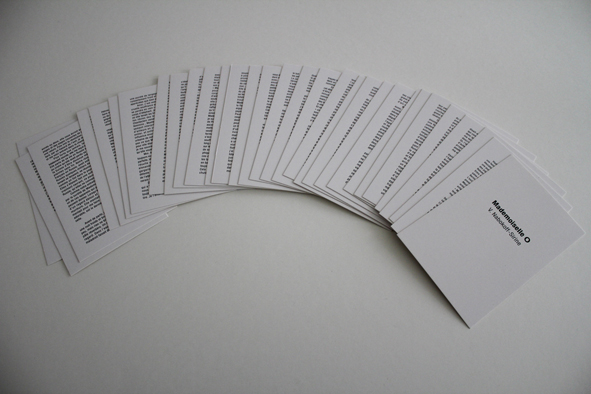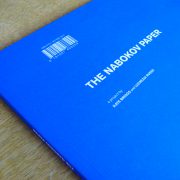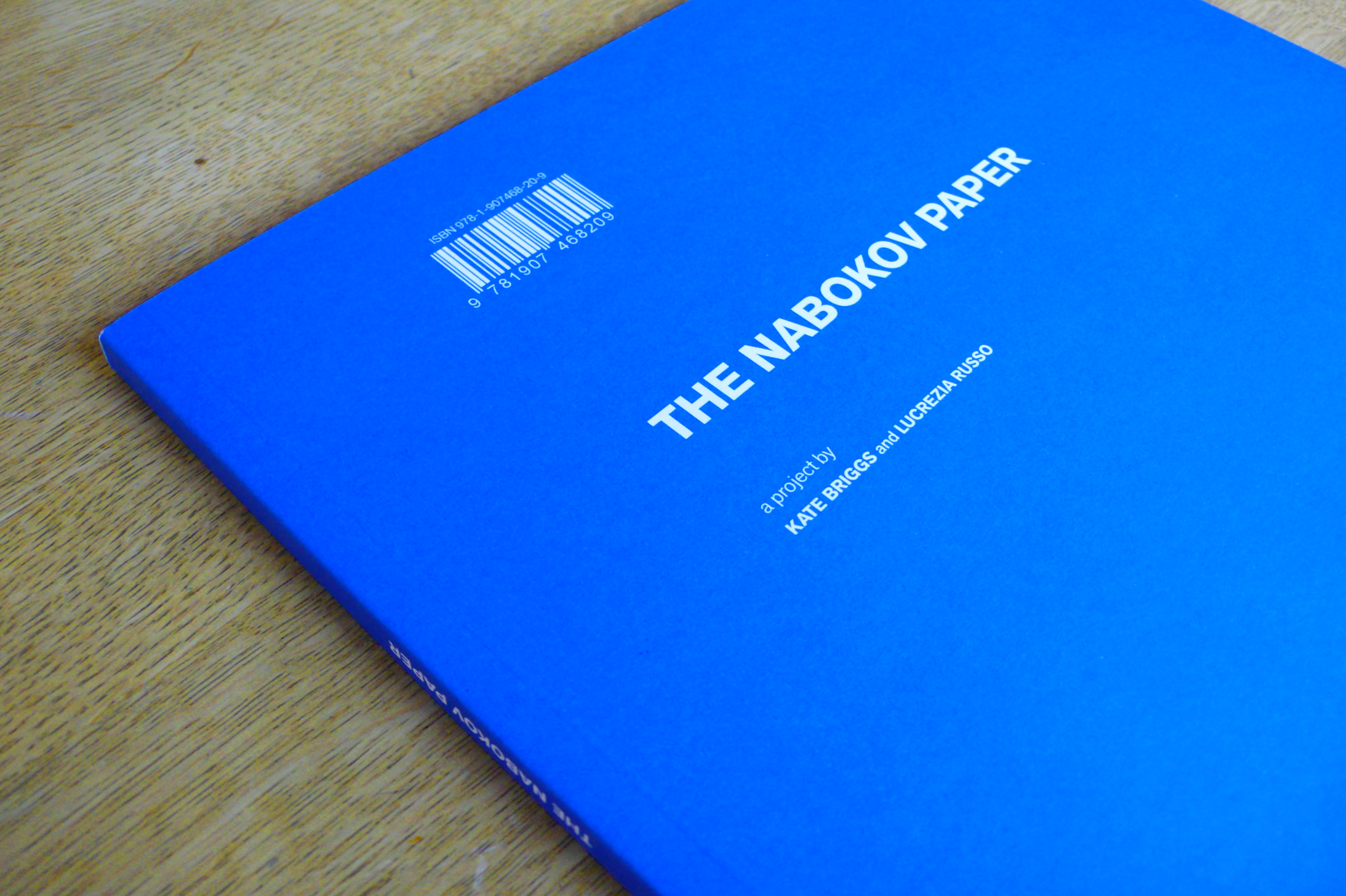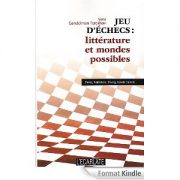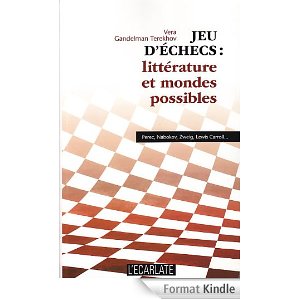Présentation de l’éditeur :
Comment l’entrecroisement des langues nourrit-il la création littéraire et contribue-t-il à construire le cadre historique, géographique et social d’une œuvre ? Ce volume rassemble des travaux portant sur les enjeux de l’hétéroglossie dans l’écriture d’un texte d’une part, et d’autre part, de façon complémentaire, dans sa traduction d’une langue à une autre. Comprendre les mobiles qui ont incité les auteurs anglophones à emprunter des expressions françaises ou étrangères, montrer comment l’entrelacs des langues participe de l’écriture littéraire et analyser la pertinence de l’interaction des langues dans un texte, voilà les questionnements qui sous-tendent l’ensemble des travaux présentés ici. Essentiellement consacré à un corpus anglophone, ce volume ouvre le champ d’investigation à des textes écrits en d’autres langues, notamment le russe et le siamois. Les réflexions engagées abordent les problématiques de la polyglossie à la fois sous l’angle théorique et critique d’une poétique du texte littéraire et sous l’angle pratique de la traduction de ces traces du multilinguisme dans un texte.
Table des matières
Emily Eells, Avant-Propos
Penser l’étranger dans la langue
Jean-Jacques Lecercle « Les mots étrangers sont les juifs de la langue »
Laurent Milesi « Altérités de la traduction : Derrida, Cixous, Beckett, Joyce, Friel »
P.L. Paddington « L’hétéroglossie ponctuelle »
Shakespeare
Anny Crunelle Vanrigh « Les mots français dans Henry V »
Mylène Lacroix « Traduire et mettre en scène l’hétéroglossie dans Henry V de Shakespeare »
Jean-Michel Déprats « De Windsor à Babel : un grand festin de langues dans The Merry Wives of Windsor »
Domaine anglophone moderne
Elise Brault « T.S. Eliot et ses intertextes étrangers : intégration et masques »
Marc Chémali « La familière étrangeté des mots étrangers dans l’œuvre de Tolkien »
Juliette Feyel « Crépuscule de l’aristocratisme, les mots étrangers dans Women in Love de D.H. Lawrence »
Ginette Katz-Roy « Les mots étrangers dans Twilight in Italy et Sea and Sardinia de D.H. Lawrence »
Françoise du Sorbier « Le vertige des codes »
Domaine anglo-franco-russe
David Shepherd « Traduire l’hétérologie, traduire Bakhtine ? »
Hélène Henry « En français dans le texte » : traduire l’hétéroglossie dans La Guerre et la Paix de Tolstoï
Julie Loison « Traduire le multilinguisme de Nabokov »
Corinne Bigot « These French clichés are symptomatic » : la mise en évidence des mots français dans Lolita »
De l’altérité à l’assimilation
Stéphanie Durrans « L’étrangeté de la langue dans « La Belle Zoraïde » et The Awakening de Kate Chopin »
Corinne Alexandre-Garner «Étranges mots étrangers et langue hantée : écrire dans la langue de l’ennemi »
Emer O’Beirne « Nancy Huston : une fugue linguistique »
Simone Rinzler « Altérité linguistique de l’Autre social : les maux étrangers de la littérature postindustrielle »
Langue et littérature siamoises
Gilles Delouche « De l’hétéroglossie à l’emprunt en siamois, des origines au xixe siècle »
Theeraphong Inthano « Hétéroglossie, glose et emprunts en siamois : Les traductions et adaptations d’œuvres dramatiques anglaises et françaises par le roi Vajiravudh (1910-1925) dit Rama VI »